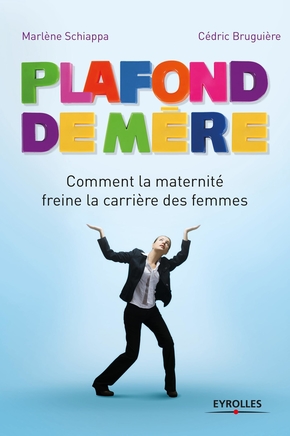En cette journée internationale des droits de la femme, il m’apparait important de souligner ce sujet toujours d’actualité.
Expression inventée par Cédric Bruguière et Marlène Schiappa en 2015 dans leur ouvrage « Plafond de mère : Comment la maternité freine la carrière des femmes », elle illustre la situation des mères désirant travailler. Sans aborder tous les sujets de l’ouvrage (plus de 200 pages d’interprétation, de témoignages et de propositions d’actions), ce dernier souligne les difficultés qu’ont les femmes à reprendre une (voir leur) activité professionnelle après une maternité (le congé parental pris ou pas). Soulignant les stéréotypes sociaux, les décisions gouvernementales (sans impact ou non abouties), les mécanismes managériaux et rappelant l’importance d’une action tripartite (monde du travail/société/individus), les auteurs dépeignent un tableau plutôt sombre, sans évolution, mais donnent tout de même des propositions d’action pour chaque sujet abordé.
https://www.huffingtonpost.fr/life/article/le-plafond-de-mere-qu-est-ce-que-c-est_85948.html
Je me permets aujourd’hui de faire un petit témoignage moi-même, un énième qui ne fera pas avancer les choses certainement mais qui permettra d’illustrer une fois de plus ce combat. https://www.doctissimo.fr/grossesse/droits-et-demarches-durant-la-grossesse/plafond-de-mere
En qualité de psychologue d’abord, dans un dispositif accompagnant les personnes licenciées pour motif économique, j’ai rencontré beaucoup de femmes. Un ratio qui m’a interpellée : certaines entreprises se séparaient plus facilement des femmes (souvent à des postes moins élevés) que des hommes. Parmi ces femmes, beaucoup de mères étaient à ces postes moins qualifiés pour des raisons personnelles : les horaires correspondaient à la vie de famille (école, garderie…) et certaines s’étaient mises à temps partiel pour justement s’occuper du quotidien (courses, ménage, repas…). Mais de ce fait, leurs allocations étaient moindres et leurs cotisation retraite aussi.
J’ai pu accompagner une femme, mère de 5 enfants, qui s’était arrêtée de travailler pour les élever et s’occuper de la maison. Elle se justifiait en disant que c’était un choix de couple, le père des enfants ayant une très bonne situation. Seulement, ils se sont séparés. Cette dame s’est alors retrouvée avec une garde alternée de 5 enfants, une pension alimentaire et le RSA. Pas d’allocation chômage puisqu’elle n’était pas en activité et un « trou » dans son CV de 10 ans ! Malgré ses compétences d’organisation et de gestion (impératives pour s’occuper d’une famille nombreuse), ces dernières n’étaient pas reconnues parce que développées dans le secteur privé et donc sans « preuves ». Elle finit par trouver une structure qui l’accueille mais qui doit la licenciée économiquement quelques mois plus tard. Le combat pour une activité professionnelle (nécessaire aujourd’hui pour trouver un logement pour 6 par exemple) recommence.
Un autre suivi me vient en tête. Une mère de 2 enfants, avait décidé de mettre sa carrière professionnelle sur pause pour s’occuper de la maison, mais surtout pour épauler son conjoint dans la création de son entreprise. Sans être salariée de cette entreprise, elle gérait le budget, les approvisionnements, les rdvs, les factures…. Et puis un jour, les conjoints se sont séparés. Monsieur a embauché quelqu’un pour prendre la place de son ex-épouse, et cette dernière s’est retrouvée avec 2 enfants (le plus souvent avec elle) et sans expérience professionnelle depuis plus de 5 ans. Les compétences développées au sein de l’entreprise n’ont pas pu être reconnues (puisque pas de preuve toujours), elle n’avait pas cotisé au chômage ou à la retraite, et avait également un « trou » dans son CV.
Plus personnellement, dans l’entreprise où je travaillais précédemment, j’ai toujours été en CDD. Non pas par rapport à mon genre mais parce que c’était la politique de l’entreprise (c’est un autre débat). Lorsque j’ai annoncé mes grossesses (sur 2 contrats différents), je n’ai (bien sûr ?) pas été renouvelée. Il n’a jamais été question par exemple de faire un contrat plus court pour aller jusqu’à mon arrêt maternité. Après la naissance de mon deuxième enfant, les modes de garde étaient plus difficiles : il fallait trouver non plus un mais deux modes de garde. J’ai donc décidé, puisque je n’étais pas salariée dans une entreprise et que mon conjoint gagnait « bien » de rester un peu à la maison le temps de trouver des gardes adaptées. Quelle ne fut pas ma surprise quand bon nombre de personnes m’ont conseillé de rester sans activité jusqu’au 3 ans de mon cadet ! Moi qui ai toujours travaillé et qui adore mon travail, cela me semblait invraisemblable. J’ai commencé mes recherches d’emploi mais il y avait toujours quelque chose qui n’allait pas : les horaires, la distance, les missions… J’ai donc pris la décision de me mettre à mon compte : d’abord parce que l’idée me plaisait (quand même) mais ensuite (et surtout ?) pour gérer mon planning et mon temps et pouvoir subvenir encore aux besoins quotidiens (horaires de crèche et d’école, ménage, courses…).
Je pense que le pire, c’est que mon conjoint souhaiterait changer d’activité et avoir plus de temps à la maison. Seulement aujourd’hui, ce n’est pas possible. Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir une partie de salaire en moins. Alors qu’aujourd’hui on maintient que l’orientation et le choix professionnel est possible toute la vie, je n’en suis pas sûre. Il y a des choix parfois qu’il faut prendre par « résignation », j’entends des choix cartésiens qui ne sont pas forcément en adéquation avec nos aspirations. Bien sûr dans quelques années, nous avons toujours le projet d’inverser les rôles. Mais pas aujourd’hui. Et c’est bien le constat de Cédric Bruguière et Marlène Schiappa, en 2015, qui n’a pas changé aujourd’hui